
Faire chanter la musique par tous en langue vernaculaire est un point commun de la théologie musicale des réformateurs qui reste d’actualité et a même été adopté par la liturgie catholique lors du concile Vatican II. Il n’en est heureusement pas de même pour ce qui concerne le rejet de toute musique instrumentale !
Sur ce point, Calvin se distingue des réformateurs de langue allemande, qui maintiennent l’orgue non seulement pour accompagner la liturgie chantée mais aussi pour d’autres moments musicaux de la « messe allemande », où la musique prend une fonction de méditation, d’ouverture, de prolongement de la prédication qui n’existe pas dans le calvinisme du XVIe siècle.
Calvin n’est plus suivi où que ce soit quant à son rejet de la musique instrumentale. La question de la prééminence de l’orgue ou des instruments autres reste en revanche d’actualité.
Calvin fit le choix d’éliminer les instruments de la liturgie. Il ne pouvait pourtant pas ignorer la présence fréquente d’instruments dans l’Ancien Testament, notamment dans les psaumes. La louange y est accompagnée par des instruments, parfois même menée par des instruments ou exprimée par la danse. Deux psaumes, en particulier, sont susceptibles de causer quelques difficultés d’interprétation à Calvin lorsqu’il fait paraître un commentaire complet du livre des Psaumes, édité pour la première fois en latin à Genève 1557 (l’année suivante en français), soit après vingt ans de défense de l’usage des seuls psaumes chantés dans le culte. Il est dans l’obligation de développer une argumentation cohérente et convaincante pour aboutir à une exégèse qui lui permette d’expliquer les deux psaumes en question, tout en excluant l’usage des instruments pour son temps. L’exercice n’est pas choses aisée, tant les deux psaumes en question sont favorables à la musique :
« Justes, réjouissez-vous en l’Eternel ! La louange sied aux hommes droits. Célébrez l’Eternel avec la harpe, Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix ! » Ps. 33, 1-3
« Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe ! Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes ! » Ps. 150, 3-6
S’il est possible d’utiliser l’Écriture de façon un peu simpliste pour appuyer un rejet de l’orgue, qui n’existait pas du temps des psaumes, il est plus difficile d’étayer une argumentation anti-instrumentale sur la base de ceux-ci. De manière pragmatique, on peut comprendre l’exclusion des percussions, associées à la danse, trop aux antipodes des habitudes musicales ecclésiastiques depuis le Moyen-Âge. Le luth est un instrument assez peu sonore, qui accompagne très bien les voix. Mais, au XVIe siècle, il est assez radicalement associé à un répertoire poétique galant, à une atmosphère de musique de cour tout à fait profane. Quant à la harpe, sa facture assez rudimentaire en fait un instrument peu sonore et peu commode, beaucoup moins répandu que le luth. Il resterait en théorie les instruments à vent, a priori bons pour un emploi liturgique.
Dans son Commentaire des psaumes, Calvin se prononce clairement pour une exclusion de tout instrument de musique de la liturgie, tout en acceptant leur usage (à des fins de louange) hors du temple [1]. Il considère que la musique n’est pas pour Dieu mais pour l’homme. Elle est une aide pour celui-ci (ou tout du moins, elle l’a été en des temps anciens), elle peut lui être agréable, mais elle n’a pas d’agrément pour Dieu [2]. C’est donc bien dans son rapport à l’homme que Calvin envisage l’utilité ou non de la musique instrumentale dans le service divin.
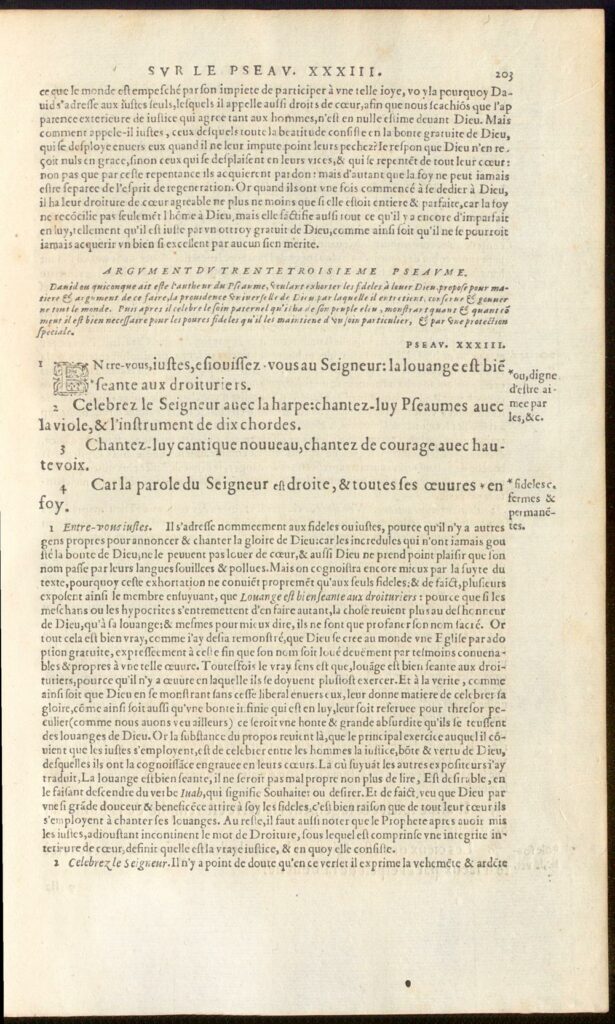
Les premiers versets du psaume 33 lui permettent de développer un raisonnement qui sera ensuite repris plus succinctement ou partiellement à chaque fois qu’un psaume exhorte à prier avec l’aide des instruments. Tout d’abord, il traduit bien les noms d’instruments de musique, et admet que le psalmiste incite à l’usage des instruments, dont l’aide n’était pas vaine. Il emploie ensuite son argument principal, à savoir que les instruments de musique appartiennent au régime de la Loi, qui a été aboli. Ils sont pour le réformateur à considérer presque de la même façon que les sacrifices, la circoncision, les règles de pureté alimentaire, qui permettaient l’alliance, mais n’ont plus sens en temps de nouvelle alliance :
« Car il faut entendre qu’il y a différence, afin que nous ne tirions pas en conséquence pour nous toutes les façons de faire qui ont esté anciennement commandées aux Juifs. Et quant à moy, je ne doute point que jouer des cymbales, toucher la harpe et la viole, et toutes ces sortes de musiques desquelles il sera souvent fait mention és Pseaumes, n’ayent esté une partie de la pédagogie, c’est-à-dire instruction puérile de la Loy. » [3]
« Quant au Tabour, la Harpe, et le Psaltérion, nous avons dit ailleurs, et faudra encores dire ci-après, que ce n’est point sans propos que les Lévites ont usé sous la Loy d’instrumens de musique : pource que Dieu a voulu enseigner jusques à la venur de Jésus-Christ par tels rudimens son peuple qui estoit encore tendre et semblable à petits enfans. »[4]
« Mais pour autant que le temps de l’age parfait n’estoit pas encores venu, il a entretenu les Juifs sous ces élémens puérils. » « Les instruments de Musique desquels il fait mention, appartienent au temps de la pédagogie. »[5]
La Loi est présentée comme une forme de pédagogie destinée à une humanité en situation d’enfance. Il invite, en suivant Paul, à un passage du régime de la Loi à celui de la grâce, c’est-à-dire d’un rapport au monde infantile à un rapport au monde adulte, émancipé. Dans son Sermon 73 sur le Deutéronome, il reprend cette idée d’enfance en l’orientant différemment, dans le but de polémiquer contre l’usage catholique des orgues, qui auraient pour but de faire danser Dieu comme un enfant. L’un des arguments qu’il trouve dans le Nouveau Testament pour aller dans le sens de sa lecture se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14 [6], qu’il interprète pour renforcer son raisonnement.
Il fait référence à deux éléments distincts du texte de Paul : la métaphore musicale et le parler en langues. La métaphore musicale concerne le verset 7 (« Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? »). Paul n’y dit pas que les instruments rendent un son indéterminé, mais qu’il importe que leur son soit déterminé, seule condition pour que ce qui y est joué soit reconnu. Il ne plaide ni pour ni contre leur usage liturgique. Plutôt que ce verset en particulier, on peut supposer que Calvin fait référence au chapitre entier, où il est question du « parler en langues », soit de la prise de parole charismatique devant une communauté en lieu et place de la prédication intelligible. Suivant Paul, il fait d’une part une analogie contestable, entre la musique et une langue, et d’autre part présuppose l’inintelligibilité de la musique. On pourrait défendre l’inverse, à savoir que la musique n’est pas une langue, mais qu’en revanche elle est intelligible.
Calvin considère donc que la musique instrumentale liturgique relève de l’ancienne Alliance et du régime de la Loi, et qu’à ce titre elle n’a pas sa place dans la liturgie de l’Église. Il ne dit pas que les instruments sont en soi diaboliques ou que la musique est mauvaise – dans la préface du psautier de Genève il en parle comme d’un don de Dieu –, mais il les exclut du culte. Il est cependant paradoxal de constater que ces psaumes, dont il ne garde pour son présent que ce qui lui convient, constitueront l’intégralité des textes des chants de sa liturgie, sans qu’il craigne que leurs exhortations ne fassent retomber le chrétien dans l’enfance de la religion.
… aux instruments de « papisterie »

Les instruments, relevant du régime de la Loi pour Calvin, sont donc comparables aux autres ornements dont il souhaite dépouiller la liturgie, soit parce qu’il les rattache à ce régime d’avant l’Évangile, soit parce qu’ils n’ont pas de fondement scripturaire. Rattacher la musique instrumentale à ces ornements liturgiques revient à en faire un symbole du catholicisme romain, ce que Calvin fait explicitement.
« […] mais quand ils font leurs sainctes assemblées ecclésiastiques, je di que pour chanter les louanges de Dieu, de remettre en usage les instruments de musique cela ne conviendroit non plus que de faire encensemens, dresser luminaires, et ramener les autres ombres de la Loy. Et pourtant les Papistes ont fait follement et sans raison d’emprunter des Juifs ceste façon de faire, comme plusieurs autres choses. »[7]
Les orgues, « instruments de papisterie » en terre calviniste, ont donc été systématiquement démontés, sauf en Hollande et à Bâle[8]. L’argument scripturaire peut être utilisé contre ces instruments qui n’existaient pas du temps de « David », mais il ne constitue de toute évidence pas le motif réel de ce rejet.
À plusieurs reprises, Calvin utilise une métaphore animale peu gratifiante (« Doncques nous recueillons que les Papistes en usant d’instrumens de musique ne sont pas imitateurs des Pères, mais vrais singes »[9]) pour désigner ce qu’il considère comme un emprunt du catholicisme romain à la religion de la Loi. La métaphore animale désigne l’imitation, elle est d’une autre nature que celle qui compare le musicien à l’oiseau, mais toutes deux appellent l’idée d’une humanité dégradée, bestialisée, en ce qu’elle ferait, par le goût de la musique instrumentale ou par l’action d’imitation, appel davantage à ses sens qu’à son intellect. Calvin se fait ici, encore une fois, l’héritier d’Augustin, ainsi dans la préface du Psautier en 1545 : « en cela, dit Saint Augustin, gît la différence entre le chant des hommes et celui des oiseaux. Car une linotte, un rossignol, un papegay chanteroient bien, mais ce sera sans entendre. »
« Entendre » signifie ici « comprendre », être intelligible. Or l’homme peut chanter, jouer une musique qui lui est intelligible, sans qu’elle ait de paroles. La musique a une intelligibilité intrinsèque, qui ne dépend pas du statut de langage qui lui est ou non accordé, mais de sa structuration interne profonde. Il est possible qu’une des raisons qui ont poussé Calvin à minimiser la part de la musique dans la liturgie réside dans sa faible instruction musicale, qui le conduit à la percevoir comme un art puissant donc dangereux, en partie magique, flattant les sens [10].
La conception « négative » qu’il a de l’art est ancienne, elle est transmise par Augustin, qui l’a lui-même héritée de Platon via Plotin. Pour Platon l’œuvre artistique, loin de donner l’existence à ce qui n’en avait pas auparavant, subit une double déperdition ontologique qui l’éloigne deux fois de la vérité (de l’idée à l’objet, de l’objet à la copie)[11]. Qui plus est cette déperdition est associée à une tare morale, car l’art, à la différence de l’artisanat qui assume n’être que copie, prétend à exprimer une vérité. À ce sujet, Calvin est plus platonicien qu’aristotélicien, ce qui est un peu anachronique au début du XVIe siècle, où partout, même hors d’Italie, on relit la Poétique et on entend l’art comme riche d’un « plus d’être » plutôt que d’un « moins d’être », et à ce titre, d’un chemin d’accès vers la transcendance.
La Parole dans la musique
Ce que Calvin craint dans la musique instrumentale semble être précisément ce qui fait qu’elle a une nécessité forte dans le culte. Elle déplace, elle saisit, elle meut, elle emmène là où on ne s’attend pas à être emmené. À ce titre – pas sous tous ses aspects cependant – elle endosse une partie de la fonction de la prédication, qui relève de l’intelligence et de la compréhension des textes bibliques, mais pas uniquement. Elle en est le reflet et le complément [12].
Il semble dommageable à la compréhension de la place de la musique dans la liturgie que la formation théologique ne comporte actuellement ni hymnologie, ni lecture, ni histoire du répertoire, hormis à Strasbourg. Il est possible (et même fréquent) de devenir pasteur sans soupçonner les vastes espaces de sens ouverts par une musique de qualité. Luther disait pourtant qu’il « ne faut point non plus ordonner pasteurs de jeunes gens qui ne se soient, à l’école, essayés à la musique et qui y soient exercés. » La musique n’a en effet pas du tout la même place chez Calvin et chez Luther.
Raphaël Picon[13] rappelle que Johann Walter, l’ami et collaborateur de Luther, dans son poème Louange et éloge de l’honorable art qu’est la musique (1538), écrit : « la musique est donnée par Dieu, en même temps que la théologie. Dieu, cachant discrètement la musique, l’a dissimulé dans la théologie »[21]. Il en déduit que pour Luther, la musique est « dans la Parole, au point d’en faire partie et d’en être l’héritière », tandis qu’elle est chez Calvin pour la Parole. On pourrait entendre cette relation entre Parole et Musique autrement, en inversant les termes de la proposition luthérienne : si l’on peut difficilement justifier, dans une perspective croyante, une Parole pour la Musique, une Parole dans la Musique fait sens. La Musique instrumentale, en tant qu’art capable de mouvoir profondément l’être humain, peut être un amplificateur de la Parole, un chemin alternatif de sa puissance. Les émotions que la musique fait naître sont cependant porteuses d’ambiguïtés, susceptibles de « parasiter » l’intelligibilité de la Parole, et d’aller ainsi à l’encontre du projet de Calvin pour le culte.
Pour rendre à la Musique son pouvoir de prédication, il convient toutefois de se placer dans le double héritage de Luther et Calvin. Ce dernier prône, à plusieurs reprises, une musique liturgique « en majesté », témoignant ainsi de son importance et du degré d’exigence qu’il a pour le culte. Quant à Luther, lorsqu’il cite des compositeurs ayant prêché l’Evangile par la musique, il mentionne les meilleurs compositeurs de son temps, comme Josquin des Prés ou Senfl. Une musique liturgique qui serait dans la continuité de celle promue par les réformateurs ne serait donc ni la musique du passé, ni une musique dans un style populaire de divertissement, ni une musique d’auteurs spécialisés dans la musique liturgique, dépourvus de reconnaissance hors de celle-ci. Il est peut-être problématique de constater que la musique liturgique navigue désormais majoritairement entre ces trois options, à l’exception de rares créations. La Passion selon Marc de Michaël Levinas [14], qui n’est pas liturgique, est un exemple passionnant de ce qui peut être imaginé aujourd’hui. Dans une autre esthétique, The Street de Nico Muhly, est susceptible d’être intégré à une liturgie du Vendredi Saint autant que d’être joué en concert.
« Poids et majesté »
Si de tout temps on a composé de nouveaux cantiques, c’est une lubie de notre époque que de les vouloir à inspirés par la musique populaire. La musique du culte est affaire sérieuse : elle a pour vocation d’élever, pas de satisfaire le goût de nos oreilles pour la facilité et le divertissement. Calvin soutenait qu’il « y a toujours à regarder que le chant ne soit léger ni volage, mais qu’il ait poids et majesté et qu’il y ait grande différence entre la musique qu’on fait pour réjouir les hommes à table et en leur maison, et entre les Psaumes qui se chantent en Eglise, en la présence de Dieu et de ses anges. » Que Brassens, Rosalia ou les Rolling Stones nous réjouissent est une chose, que l’on joue Amélie Poulain ou du Léonard Cohen au culte en est une autre. Le rock chrétien, les cantiques sur accords de guitare au parfum de camp scout, ont bien leur place et leur valeur en tant qu’expressions créatives d’une spiritualité individuelle, mais à moins de vouloir assimiler dans le protestantisme ce que le concile Vatican II a produit de plus mauvais, ils ne devraient pas constituer la liturgie de l’Église.
Le renouvellement du répertoire liturgique pourrait donc être le fruit de la création de compositeurs de musique savante contemporaine, comme cela fut le cas autrefois. On pourra opposer deux objections à cette proposition : la première est d’ordre esthétique, la seconde est d’ordre pratique, les deux étant liées au caractère difficile de cette musique. Il est vrai que l’exigeante réception de la musique contemporaine présente un écart vertigineux avec notre environnement sonore, où sont continuellement diffusés des sons qui reposent sur des harmonies extrêmement conventionnelles, une polyphonie très limitée, et des rythmes faciles et dansants. Il semble cependant que les a priori esthétiques pourraient être mis de côté, a minima pour ce qui concerne la musique instrumentale : est-ce que le culte n’est pas précisément le lieu où la tradition héritée pourrait se conjuguer avec ce qui « décoiffe » et déplace ? Est-ce que la musique du culte a réellement pour fonction de plaire ? Est-ce que les textes de l’Écriture plaisent toujours ? Est-ce qu’une prédication véritablement bonne plait, dans le sens où elle ne dérange pas ? On gagnerait parfois à entendre de la musique plus avant-gardiste au culte, et à commander des cantiques nouveaux à des compositeurs sensibles à la musique sacrée, comme Matthias Pintscher (Bereshit), ou autres grands créateurs, avec comme contrainte conséquente de produire un répertoire chantable par tous.
Lire la série Calvin et la musique : Danger ou atout ? Le pouvoir de la musique selon Calvin (1) La musique pour tous selon Calvin (2)
[1] « Car je confesse qu’encores aujourd’hui, quand les fidèles se resjouissent d’instrumens de musique, ils doyvent avoir ce but de conjoindre les louanges de Dieu avec leur resjouissance. »Jean Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le livre des Pseaumes : avec une table fort ample des principaux points traittés és commentaire, vol. 1, p. 263. (psaume 33)
[2] « Car aussi Dieu n’a point voulu qu’on jouast de la harpe, comme si à la façon des hommes il prenoit plaisir en la mélodie. » Ibid., vol. 2, p. 200. (psaume 92)
[3] Id. ibid.
[4] Jean Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le livre des Pseaumes : avec une table fort ample des principaux points traittés és commentaire, vol. 2, p. 116. (psaume 81)
[5] Ibid., vol. 2, p. 200. (psaume 92)
[6] « Car sainct Paul ne permet point de bénir Dieu en l’assemblée publiquement des fidèles en langage qui ne soit entendu de la compagnie. Certes la voix de l’homme, encores qu’elle ne soit pas entendue du commun, est bien plus excellente que tous les instrumens de musique, qui sont choses mortes. » (Ibid., vol. 1, p. 263, psaume 33) « […] Car combien qu’il ne nous soit point défendu d’user particulièrement d’instruments demusique, toutesfois ils sont rejettez des temples, par le commandement manifeste du sainct Esptit, quand sainct Paul ne permet point louer ou prier Dieu qu’en langue cognue. » (Ibid., vol. 2, p. 25, psaume 72)
[7] Ibid., vol. 1, p. 263. (psaume 33). L’argumentation en question n’est pas réservée aux psaumes, on la trouve dans d’autres commentaires de Calvin, ainsi dans le Sermon LXXIII sur Deutéronome (CO 27, 69) « Comme les hommes feront beaucoup de pompes, et de fanfares pour servir à Dieu, en beaux temples, en belles peinctures, en belles tapisseries, en perfums, en cloches, en luminaires, et en tout ce menu bagage : il leur semble que Dieu s’esiouit, et quand ils sonnent des orgues, qu’il le feront dancer comme s’il estoit un petit enfant. Or ne nous amusons point à tous ces menus bagages la : car Dieu veut estre servi en verité, en droicture, et en rondeur de cœur »25. Instruments « papistes », ramènent les catholiques en enfance de religion, au même stade que les israélites pour lesquelles Dieu avait, « ad tempus pedagogiae », permis la musique. »
[8] Beat Föllmi, « Le « Psautier de Strasbourg », op. cit., p. 47.
[9] Ibid., vol. 2, p. 200. (psaume 92)
[10] « Si quelqu’un objecte que la musique sert de beaucoup à resveiller les esprits des hommes, et esmouvoir leurs coeurs, je le confesse, mais il est tousjours à craindre que quelque corruption n’y surviene obliquement, qui corrompe le pur service de Dieu, et enveloppe les hommes en quelque superstition. », Ibid. vol. 1, p. 263. (psaume 33)
[11] Catherine Kintzler, L’imitation en art : aliénation ou invention ?, https://www.mezetulle.fr/limitation-en-art-alienation-ou-invention/, juillet 2018.
[12] Raphël Picon le dit en d’autres termes : « Le culte est aussi une affaire de musique et de chant. Pas seulement parce que ces deux confèrent à la liturgie une dimension esthétique, un plus de beauté et d’émotion, mais parce qu’ils soutiennent le culte dans ses fonctions propres et dans sa dynamique théologique. La musique et le chant contribuent réellement à rendre le culte possible. Et pourtant, musique et chant ne se laissent guère assigner aux places que nous pourrions vouloir qu’ils gardent. Par l’imprévisibilité, l’amplitude et la diversité des effets qu’ils peuvent susciter, ils se dérobent à toute maîtrise et restent insoumis à toute mise en ordre fut-elle liturgique. Si tous deux participent au culte en le soutenant dans ses fonctions, ils le transforment de l’intérieur et lui redonnent une part d’inattendu et d’inouï. » Raphaël Picon, La musique et le chant dans le culte protestant (cours de théologie pratique à distance), non publié, 2015, p. 2.
[13] Raphaël Picon, La musique et le chant dans le culte protestant (cours de théologie pratique à distance), op. cit., p. 4.
[14] Passion selon Marc, une Passion après Auschwitz, commandée au compositeur Michael Levinas par le comité du Jubilé qui s’était constitué pour célébrer 2017 à Lausanne.